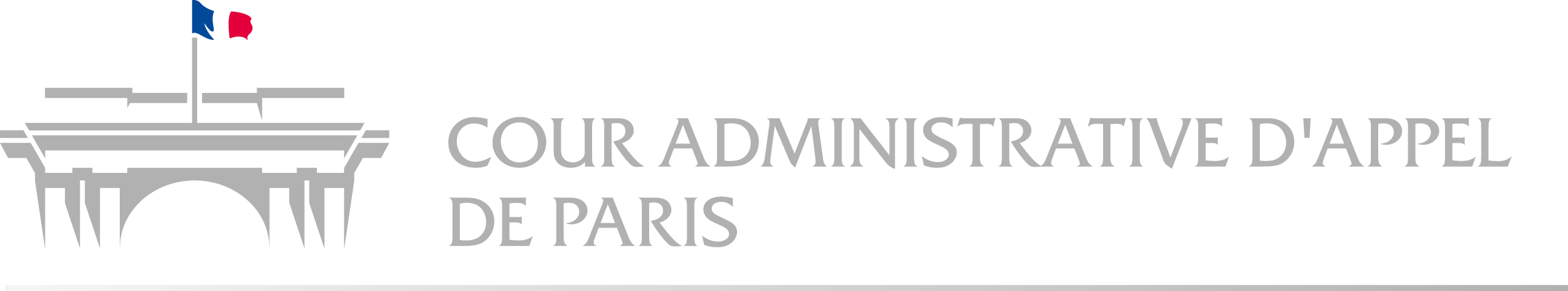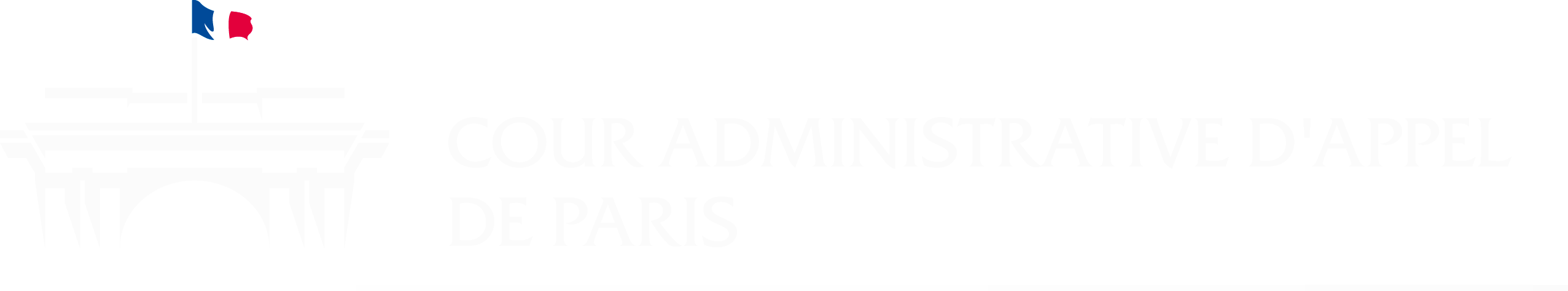Par un arrêt du 4 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris juge que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) aurait dû exiger du fabricant du Levothyrox qu’il fasse figurer sur le conditionnement extérieur du médicament des éléments assurant une information complète quant à son changement de formule. L’agence a ainsi commis une faute. La Cour rejette toutefois la demande indemnitaire formée contre l’Etat par des patients qui invoquaient un préjudice d’anxiété imputable à ce défaut d’information. En effet, le préjudice d’anxiété répond à des critères stricts, non remplis dans ce cas.
Les spécialités à base de lévothyroxine sont indiquées dans le traitement des pathologies thyroïdiennes. A la suite d’une demande de l’ANSM de resserrer les spécifications de teneurs en substance active pendant toute la durée de vie du produit, dans le but d’améliorer la stabilité de ce type de médicament et de réduire ainsi les effets négatifs résultant de sa marge thérapeutique étroite, le laboratoire Merck, qui fabriquait le médicament sous la dénomination de Levothyrox, en a modifié la formule. Après avoir constaté que l’un des excipients, le lactose, était à l’origine de la fluctuation de la substance active, ce laboratoire a décidé de le remplacer par deux autres excipients : le mannitol et l’acide citrique. Une demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché du Levothyrox a alors été déposée auprès de l’ANSM, qui, par une décision du 27 septembre 2016, a autorisé cette modification.
Dès la commercialisation de la nouvelle formule en mars 2017, de nombreux patients ont fait état d’effets indésirables, les signalements atteignant le nombre de 17 000 en novembre de la même année. La ministre de la santé a alors autorisé l’importation temporaire du Levothyrox ancienne formule ainsi que la mise sur le marché d’autres spécialités à titre d’alternatives thérapeutiques. Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité du laboratoire et de l’exploitant en raison d’un défaut d’information, le changement de formule n’ayant pas été mentionné sur les boîtes et la notice du médicament.
De son côté, la cour administrative d’appel de Paris était saisie par des patients qui recherchaient cette fois-ci la responsabilité de l’Etat, du fait des fautes commises par l’ANSM, chargée de veiller à la sécurité des médicaments.
La Cour relève que la mise sur le marché de la nouvelle formule du Levothyrox s’est accompagnée d’une modification du conditionnement extérieur (changement de dimension de la boîte, de couleur de la mention du dosage et d’une bordure, et enfin du logo), ainsi que d’une modification de la notice indiquant la liste des nouveaux excipients et la date de la dernière mise à jour. Toutefois, ces seules modifications, sans mention expresse, visible et compréhensible du changement de formule du médicament, étaient insuffisantes pour assurer l’information complète du patient. Or l’ANSM était informée par des précédents étrangers des risques d’effets indésirables induits par tout changement de formule d’un médicament à marge thérapeutique étroite. Dans ces conditions, . En revanche, elle ne retient pas les autres fautes invoquées par les requérants.
La Cour juge ensuite que si les requérants ont subi des effets indésirables en raison de la nouvelle formule du Levothyrox, et s’ils invoquaient l’angoisse qu’ils ont connue avant l’adaptation de la posologie ou le retour à une spécialité correspondant à l’ancienne formule, ils n’établissaient pas avoir couru un risque élevé de développer une pathologie grave en raison de leur traitement par la nouvelle formule. Elle en déduit qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété. On peut relever que les requérants avaient déjà obtenu du juge judiciaire la condamnation de la société Merck à les indemniser de leur préjudice moral temporaire, ce qui explique qu’ils aient demandé la condamnation de l’Etat à les indemniser d’un autre préjudice, le préjudice d’anxiété. Toutefois, celui-ci suppose, en vertu de la jurisprudence, la conscience d’un risque élevé de développer une pathologie grave. Or, si cette condition a été jugée remplie en matière d’amiante ou encore du fait de la pollution par le chlordécone, comme la Cour l’a reconnu par un arrêt très récent, elle ne l’était pas dans le cas du Lévothyrox. Le préjudice invoqué n’étant ainsi pas établi, la Cour rejette les demandes indemnitaires dont elle était saisie.